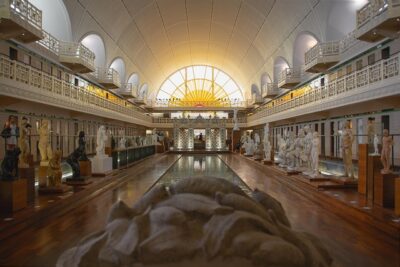L’odorat comme nouvelle expérience sensorielle dans les musées : comment les lieux culturels réinventent-ils l’émotion ?

Pour beaucoup, la culture est surtout un vecteur d’émotions. Nombreux sont celles et ceux ayant ressenti quelque chose d’indéfinissable en observant une toile de maître ou en écoutant un classique de la musique.
Et si la découverte culturelle ne passait plus seulement par les yeux ou l’ouïe ?
Dans les musées, autour des monuments ou au fil des expositions, un nouveau sens s’éveille doucement : l’odorat. Porté par les avancées des études sensorielles et la recherche d’une expérience client toujours plus immersive, le marketing olfactif trouve peu à peu sa place dans l’univers culturel.
Et avec lui, l’envie de créer des expériences sensorielles au musée uniques, mémorables, et intimes.
Le marketing olfactif dans la culture : pourquoi maintenant ?
Le marketing olfactif a longtemps été cantonné aux points de vente, au secteur de la parfumerie ou à l’hôtellerie de luxe. Il gagne aujourd’hui les lieux patrimoniaux et les institutions culturelles. Certains y voient une évolution logique, à l’heure où les visiteurs recherchent davantage qu’un simple savoir : ils veulent ressentir.
Malgré son importance, l’odorat est un sens souvent oublié. Pourtant, son empreinte est aussi profonde qu’elle est passive. En effet, ce que nous sentons réactive notre mémoire, nos émotions, et nos récits intérieurs.
Notre nez est un formidable outil qui permet de différencier un lieu, tout en le parfumant d’une identité propre. C’est donc un allié de poids pour amplifier la force d’un message muséographique. Dans une époque marquée par la recherche d’authenticité, le marketing olfactif dans la culture devient ainsi un stimulus puissant pour reconnecter publics et œuvres.
Faire ressentir plutôt que montrer : les atouts des odeurs au musée
Un sens directement relié aux émotions et à la mémoire
Loin d’être accessoire, l’odorat est le seul de nos cinq sens à dialoguer directement avec le système limbique, siège des émotions et de la mémoire. C’est ce lien direct qui explique le phénomène de la « madeleine de Proust » : une odeur, même fugace, peut raviver un souvenir entier, chargé d’affect. Contrairement à la vue ou à l’ouïe, qui passent par des filtres cognitifs, l’olfaction agit en profondeur, sans médiation consciente.
En muséographie, cette stimulation olfactive permet d’ouvrir des portes sensibles souvent plus puissantes qu’un cartel ou un audioguide. Elle amplifie la résonance intime entre l’œuvre et le visiteur. Sentir devient alors une autre manière de comprendre, de s’immerger, de tisser un lien émotionnel avec le patrimoine. L’expérience sensorielle devient plus profonde, plus personnelle, et donc infiniment plus marquante.
Stimuler l’imaginaire du visiteur par les senteurs
Vous avez remarqué ? Lorsqu’on souhaite s’imprégner d’une odeur, on ferme les yeux. Ce réflexe n’est pas anodin. Derrière les paupières closes, l’imagination a toute sa place.
Une senteur boisée, un soupçon de fragrance florale, une note épicée : en jouant sur les molécules odorantes, les lieux culturels peuvent influencer la manière dont un visiteur perçoit une œuvre, une époque, ou une ambiance.
Par exemple, une immersion olfactive pendant une exposition sur l’Égypte ancienne fait gagner cette dernière en intensité si l’air y diffuse des effluves de papyrus ou de myrrhe. Les stimuli olfactifs activent ainsi l’imagination, renforcent le storytelling sensoriel et donnent vie à ce qui aurait pu rester distant.
Renforcer l’impact émotionnel d’une œuvre ou d’un parcours
Certains musées intègrent aujourd’hui des diffuseurs de parfum dans leurs espaces pour accompagner une scénographie, une œuvre ou un récit. Une peinture évoquant un jardin peut être accompagnée d’une odeur florale. Une pièce historique, d’une senteur musquée et chaleureuse.
Ce travail sur l’ambiance olfactive pendant un événement décuple l’impact émotionnel. L’œuvre n’est plus seulement vue, elle est ressentie, vécue à travers plusieurs canaux sensoriels.
C’est ce qu’a expérimenté par exemple la Maison de la Truffe d’Occitanie, qui a intégré des diffuseurs olfactifs dans son parcours permanent : les visiteurs peuvent sentir les effluves du précieux champignon et de toutes les variétés présentées. Une manière immersive de découvrir le « diamant noir » dans toute sa complexité.
Créer des souvenirs durables grâce à l’olfactif
Selon une étude de l’Inserm, les souvenirs liés aux odeurs sont plus durables que ceux associés aux images ou aux sons. C’est une force précieuse pour les musées qui cherchent à laisser une empreinte mémorielle forte.
Une fragrance signature, subtilement diffusée, peut devenir un marqueur de l’expérience vécue. En cela, elle joue un rôle dans la fidélisation, dans le bouche-à-oreille, et dans l’envie de revenir. L’univers olfactif devient alors un véritable outil d’engagement émotionnel.
Adapter les senteurs aux typologies de publics et de parcours
Tout le monde ne perçoit pas les odeurs de la même manière. Il est donc essentiel d’adapter les diffuseurs, les fragrances, leur intensité ou leur fréquence à la typologie de public.
Certains dispositifs comme ceux de Scentys, permettent une diffusion ciblée ou à la demande. Ce souci d’adaptabilité est également la clé pour intégrer l’olfactif dans une démarche inclusive (accès pour les personnes déficientes visuelles, jeunes publics, etc.).
Des dispositifs olfactifs innovants au service de la médiation culturelle
Les technologies au service du marketing expérientiel pour un musée ont considérablement évolué. Aujourd’hui, il existe des diffuseurs de parfum intelligents, discrets et programmables, capables de créer une ambiance olfactive parfaitement maîtrisée, sans perturber les œuvres ni l’espace.
À l’instar du Musée International de la Parfumerie à Grasse, certaines institutions proposent désormais des parcours olfactifs interactifs. Les visiteurs y découvrent les matières premières emblématiques de la parfumerie, mises en scène à travers des dispositifs sophistiqués de diffusion de senteurs.
Certaines institutions ponctuent ainsi les parcours de cartels parfumés ou de capsules dans le même registre. Ailleurs, des diffuseurs muraux s’intègrent directement à la scénographie, modulant les stimuli olfactifs sans altérer la conservation des collections.
Parmi les solutions les plus performantes, les diffuseurs développés par Scentys se distinguent. Ces derniers sont en effet pensés pour les environnements sensibles, comme celui des musées.
Certains permettent une diffusion sèche sans alcool ni solvant, qui s’active au passage du visiteur ou lorsque ce dernier appuie sur un bouton. Hormis son côté interactif, cette technique assure également le respect des œuvres.
D’autres diffuseurs Scentys emploient la technologie de la micro-nébulisation, parfumant ainsi agréablement l’espace. Ils offrent une maîtrise totale de l’intensité, de la durée et de la spatialisation de la senteur, sans surcharger l’air ambiant.
Vers une identité olfactive pour les musées ? Enjeux et perspectives
Tout comme une signature sonore, une identité olfactive peut devenir l’élément distinctif d’un lieu. Certains lieux culturels imaginent désormais leur univers olfactif comme un prolongement de leur marque, au même titre que leur logo ou leur charte graphique.
Cette démarche va au-delà de l’exposition ponctuelle. Elle s’inscrit dans une logique de différenciation, de stratégie expérientielle et de cohérence sensorielle. Un parfum d’ambiance soigneusement choisi peut accueillir les visiteurs à l’entrée, les accompagner dans leur parcours, et même être proposé à la vente en boutique.
Ce croisement entre parfumerie, culture et expérience client reflète une tendance forte : celle d’une stratégie fragrante de plus en plus intégrée et émotionnelle.
Le marketing olfactif dans la culture ne se résume pas à diffuser des senteurs agréables. Il agit comme un véritable levier d’émotion, de différenciation et d’engagement sensoriel. Il est capable de transformer profondément la relation entre le visiteur et le lieu culturel.
En misant sur l’odorat, les musées renouent ainsi avec un sens souvent oublié, mais profondément humain. Après tout, l’humanité n’est-elle pas la palette sur laquelle se forme l’Art en tant que tel ?